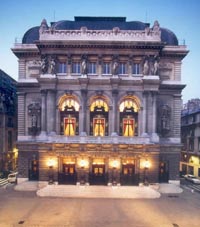
Opéra Comique à Paris
LETTRES A LA PRINCESSE KOURAKIN.
LETTRE VIII.
Le Kain. — Brizard.—Mademoiselle Dumesnil. — Monvel. — Mademoiselle Raucour. — Mademoiselle Sainval. — Madame Vestris. — Larive. — Mademoiselle Clairon. — Talma — Préville. — Dugazon. — Mademoiselle Doligny. — Mademoiselle Contat. — Molé. — Fleury. — Mademoiselle Mars. — Mademoiselle Arnoult. — Madame Saint-Huberti. — Les deux Vestris.— Mademoiselle Pélin. — Mademoiselle Allard.— Mademoiselle Guimard.— Carlin. — Cailleau. — Laruette. — Madame Dugazon.
Un de mes plus doux délassemens était
d'aller au spectacle, et je puis vous dire qu'il brillait sur la
scène des acteurs si admirables, que beaucoup d'entre eux n'ont
jamais été remplacés. Je me souviens parfaitement
d'avoir vu jouer le célèbre Le Kain : quoique je fusse trop
jeune alors pour apprécier son grand talent, les applaudissemens,
les transports unanimes qu'il excitait me prouvaient assez combien
ce tragédien était supérieur. La laideur de
Le Kain, toute prodigieuse qu'elle fût, disparaissait dans
certains rôles. Le costume de chevalier, par exemple, adoucissait
l'expression sévère et repoussante d'une figure dont tous
les traits étaient irréguliers, en sorte qu'on pouvait
le regarder quand il jouait Tancrède ; mais dans le rôle d'Orosiuane
où je l'ai vu une fois, j'étais placée fort près de
la scène, et le turban le rendait si hideux, bien que j'admirasse
sa noble et belle manière, qu'il me faisait peur.
A l'époque où Le Kain jouait
les premiers rôles, et même assez longtemps après, j'ai vu Brizard
ainsi que mademoiselle Dumesnil. Brizard remplissait les rôles de
pères ; la nature semblait l'avoir créé pour cet emploi
: ses cheveux blancs, sa taille imposante, son superbe organe lui
donnait le caractère le plus noble, le plus respectable qu'on puisse
imaginer. Il excellait surtout dans le Roi Lear et dans l'Œdipe
de Ducis. Vous auriez réellement cru voir ces deux vieux
princes si malheureux et si touchans, tant il y avait de grandiose
dans l'aspect de celui qui les représentait.
Mademoiselle Dumesnil, quoique petite
et fort laide, excitait des transports dans les grands rôles tragiques.
Son talent était fort inégal : elle tombait parfois
dans la trivialité, mais elle avait des momens sublimes.
En général, elle exprimait mieux la fureur que la
tendresse, si ce n'est la tendresse maternelle, car un de ses plus
beaux rôles était Mérope. Il arrivait quelquefois
à mademoiselle Dumesnil de jouer une partie de la pièce sans produire
aucun effet; puis, tout à coup, elle s'animait; son geste, son organe,
son regard, tout devenait si éminemment tragique qu'elle
enlevait les suffrages de toute la salle. On m'a assuré qu'avant
de paraître en scène elle buvait une bouteille de vin et qu'elle
s'en faisait tenir une autre en réserve dans la coulisse.
Un des acteurs les plus remarquables du Théâtre Français
dans la tragédie et la haute comédie, était
Monvel. Quelques désavantages physiques et la faiblesse de
son organe l'ont empêché de se placer au premier rang, mais
son ame, sa chaleur, et surtout l'extrême justesse de sa diction,
ne laissaient rien à désirer. A mon retour en France il avait
quitté les rôles de jeunes premiers pour ceux des pères nobles.
Je lui ai vu jouer alors Auguste, de Cinna et l'Abbé
de l'Épée d'une manière admirable; dans ce dernier
rôle il était si parfait de naturel, qu'un jour, au moment
où en quittant la scène il saluait les personnages de la pièce,
je me levai et je lui rendis son salut. Les personnes qui étaient
avec moi dans la loge s'en amusèrent beaucoup.
Le début le plus brillant
que je me rappelle avoir vu est celui de mademoiselle Raucour dans
le rôle de Didon. Elle avait tout au plus dix-huit ou vingt ans.
La beauté de son visage, sa taille, son organe, sa diction,
tout en elle promettait une actrice parfaite; elle joignait à tant
d'avantagés un air de décence remarquable, et une
réputation de sagesse austère, qui la firent rechercher alors
par nos plus grandes dames; on lui donnait des bijoux, ses habits
de théâtre, et de l'argent pour elle et pour son père qui
ne la quittait jamais. Plus tard, elle a bien changé de manière
d'être : on prétend que l'heureux mortel, qui le premier
triompha de tant de vertus, fut le marquis de Bièvres, et que lorsqu'elle
le quitta pour un autre amant, il s'écria : Ah! l'ingrate
à ma rente ! Si mademoiselle Raucour n'est point restée
sage, elle est restée grande tragédienne; mais sa
voix est devenue tellement rauque et dure, que si l'on fermait les
yeux on croyait entendre un homme. Elle n'a quitté qu'à sa
mort le théâtre, où elle a fini par jouer les rôles de mères
et de reines avec infiniment de succès.
J'ai vu jouer aussi mesdemoiselles
Sainval et madame Vestris, sœur de Dugazon. Les deux premières
pleuraient un peu trop constamment; mais elles me semblaient, surtout
la cadette, plus tragédienne que madame Vestris, qui, toute-belle
qu'elle était, n'a jamais obtenu de grands succès, si ce
n'est dans le rôle de Gabrielle de Vergy où l'effet qu'elle produisait
au dernier acte, était déchirant; il faut dire aussi
que cette scène est horrible.
Larive, qui pour son malheur succédait
à Le Kain, dont on n'avait point encore perdu le souvenir, avait
plus de talent que les vieux amateurs ne voulaient lui en reconnaître;
la comparaison seule lui faisait tort, car il ne manquait ni de
noblesse ni d'énergie. Son visage était beau; il était
grand, bien fait, mais jamais d'aplomb sur ses jambes, ce qui faisait
dire qu'il marchait à côté de lui.
Larive avait très bon ton et causait
avec esprit, même de choses qui n'avaient point rapport à son art,
en sorte qu'il voyait la bonne compagnie. Mon frère me le présenta,
et comme je le savais lié intimement avec mademoiselle Clairon,
je lui témoignai une fois le désir de rencontrer cette
grande tragédienne que je n'avais jamais vue jouer. Il m'engagea
aussitôt à diner chez lui pour me faire trouver avec elle, ce que
j'acceptai. Deux jours après, je me rendis à la maison qu'il avait
fait construire et qu'il habitait dans le Gros-Caillou. Cette maison
était charmante, arrangée avec un goût parfait,
outre qu'un fort beau jardin y faisait jouir dans Paris du charme
de la campagne. Larive me promena dans ses berceaux, sous ses vignes
grimpantes à la manière antique, comme on en voit encore aux environs
de Naples ; et comme nous venions de rentrer dans le salon pour
dîner, on annonça mademoiselle Clairon. Je me l'étais
figurée très grande; elle était au contraire fort
petite et fort maigre. Elle tenait sa tête extrêmement élevée,
ce qui lui donnait de la dignité. Du reste, je n'ai jamais
entendu parler avec autant d'emphase; car elle conservait toujours
le ton tragique et les airs d'une princesse; mais elle me parut
instruite et spirituelle. J'étais à table à côté d'elle,
et je jouis beaucoup de sa conversation. Larive lui témoignait
un respect profond; les égards qu'il avait pour elle annonçaient
à la fois de l'admiration et de la reconnaissance; c'était
sous ces deux rapports en effet que sans cesse il parlait d'elle.
Lorsque je suis rentrée eu
France, j'ai été charmée de revoir Larive que
j'ai rencontré souvent à Epinay chez la marquise de Groslier.
N'étant plus au théâtre alors, il habitait une charmante
campagne, située près de là, et madame de Groslier était
enchantée de ce voisinage. Il nous faisait des lectures ravissantes;
la manière dont il disait les vers acquérait un nouveau prix
de la beauté de son organe.
Talma, notre dernier grand acteur
tragique, a, selon moi, surpassé tous les autres. Il y avait
du génie dans son jeu. On peut dire de plus qu'il a révolutionné
l'art : d'abord en faisant disparaître la déclamation
ampoulée et maniérée, par sa diction naturelle
et vraie, ensuite, en forçant à l'innovation dans les costumes,
attendu qu'il s'habillait en grec et en romain pour jouer Achille
et Brutus, ce dont je lui sus un gré infini. Talma avait
une des plus belles têtes, un des visages les plus mobiles qu'on
put voir; et, si loin qu'allât la chaleur de son jeu, il restait
toujours noble, ce qui me semble une première qualité dans
l'acteur tragique. Son organe était quelquefois un peu sourd;
il convenait mieux aux rôles furieux ou profonds qu'il ne convenait
aux rôles brillans : aussi était-il principalement admirable
dans ceux d'Oreste et de Manlius; mais dans tous, il avait plusieurs
momens sublimes. Le dernier qu'il ait composé n'a point été
joué depuis lui. Personne n'oserait, je crois; car Talma
s'y était montré supérieur à lui-même: ce n'était
plus un acteur, c'était bien Charles VI, un malheureux roi,
un malheureux fou, dans toute son effrayante vérité.
Hélas ! la mort a suivi de près le triomphe; et ce que tout
Paris applaudissait avec de si grands transports, c'était
le chant du cygne.
Talma était un homme excellent,
et le plus facile à vivre qu'on puisse rencontrer. Il faisait habituellement
peu de frais dans la société; il fallait, pour l'animer,
qu'un mot de la conversation remuât un intérêt de son cœur
ou de son esprit; alors il était fort intéressant
à entendre, principalement quand il parlait de son art.
La comédie a peut-être encore
été plus riche en talles que la tragédie. J'ai
eu souvent le bonheur de voir jouer Préville. Voilà l'acteur
parfait, inimitable! Son jeu, plein d'esprit, de naturel, de gaieté,
était aussi le plus varié. Jouait-il tour à tour Crispin,
Sosie, Figaro, vous ne reconnaissiez pas le même homme, tant les
nuances de son comique étaient inépuisables : aussi
n'a-t-on point remplacé Préville. Il était
si parfaitement vrai par nature, que tous ceux qui depuis
ont voulu l'imiter ne sont parvenus qu'à nous montrer sa charge.
Je n'en excepte point Dugazon, qui certes avait un grand talent;
mais qui, dans le rôle de Figaro du Barbier de Séville,
par exemple, n'a jamais approché de son modèle.
J'ai plusieurs fois dîné
avec Préville; il était rare de rencontrer un aussi
aimable convive; sa gaieté si spirituelle nous charmait tous.
Il racontait à merveille une foule d'anecdotes extrêmement piquantes,
et l'on recherchait avec empressement les occasions de se trouver
avec lui.
Dugazon, son successeur dans les
rôles comiques, eût été un excellent comédien,
si l'envie de faire rire le public ne l'eût pas entraîné
souvent jusqu'à la farce. Il jouait admirablement bien certains
rôles de valet; il avait du mordant, un masque parfait, et peut-être
aurait-il égalé Préville s'il avait dédaigné
la charge. Mais ce qui peut faire croire que sa nature le portait
à ce misérable genre, c'est que la nuance qui existait à
la scène entre lui et son devancier se montrait aussi dans les salons
où Préville était un homme aimable, et Dugazon un
farceur de beaucoup d'esprit. On ne le recevait donc quelquefois
que pour amuser les convives; car il était fort amusant,
surtout après dîner. Dugazon a été atroce pendant
la révolution; il fut un de ceux qui allèrent chercher le
roi à Garennes, et un témoin oculaire m'a dit l'avoir vu
à la portière de la voiture, le fusil sur l'épaule. Notez
que cet homme avait été comblé des bienfaits
de la cour; principalement par M. le comte d'Artois.
Je me souviens d'avoir vu mademoiselle
Doligny dans les rôles dé jeunes premières, qu'elle jouait
avec une rare perfection. Elle avait à la fois tant de vérité,
d'esprit et de décence, que son grand talent faisait tout-à-fait
oublier sa laideur. J'ai vu aussi débuter mademoiselle Contat.
Elle était extrêmement jolie et bien faite, mais si mauvaise
dans les premiers temps, que personne ne pouvait prévoir
qu'elle deviendrait une aussi excellente actrice. Sa charmante figure
ne suffisait pas toujours pour la mettre à l'abri des sifflets,
lorsque Beaumarchais lui confia le rôle de Suzanne dans le Mariage
de Figaro. A partir de ce moment, elle marcha de succès en succès
: d'abord dans l'emploi des grandes coquettes, puis enfin dans des
rôles plus convenables à son âge, et surtout à sa taille qui, par
malheur, avait pris trop d'embonpoint.
Mademoiselle Contat avait épousé
M. de Parny, neveu du célèbre poète de ce nom; mais son mariage
ne fut déclaré qu'à l'époque où elle quitta
le théâtre; elle a conservé jusqu'à sa mort un visage
charmant; je n'ai jamais vu de sourire plus enchanteur; comme elle
avait infiniment d'esprit, sa conversation était tout-à-fait
piquante, et je la trouvais si aimable que je l'invitais souvent
à venir chez moi.
Mademoiselle Contat était
admirablement bien secondée dans tous ses rôles par Molé,
qui jouait presque toujours avec elle. Molé, sans avoir jamais
égalé Préville, était pourtant un grand
acteur; il avait de la grâce et de la dignité; il tenait;
la scène comme on dit, outre que j'ai peu vu de talent aussi varié,
et surtout aussi brillant qu'était le sien. Je l'ai reçu
chez moi plusieurs fois ; quoique son jeu fût très-spirituel,
Molé n'avait rien de remarquable dans un salon sous le rapport
de l'amabilité, si ce n'est un excellent ton.
Fleury, qui après l'avoir doublé
lui a succédé dans les grands rôles, est le dernier
qui nous ait conservé les traditions de la haute comédie.
Il avait moins de verve et moins d'élévation que Molé;
mais personne n'a joué comme lui les jeunes grands seigneurs.
Comme il avait beaucoup d'esprit et de fort bonnes manières, il
voyait souvent de près la haute société, et il en
avait si bien saisi les usages, les agrémens et les travers,
qu'il nous offrait encore, il y a peu d'années, une copie
parfaite de modèles qui avaient disparu.
A l'époque où tous les grands
acteurs dont je vous parle commençaient à vieillir, il s'élevait
près d'eux un jeune talent, qui fait aujourd'hui l'ornement de la
scène française : mademoiselle Mars jouait alors avec une perfection
inimitable les rôles d'ingénues ; elle excellait dans celui
de Victorine du Philosophe sans le savoir, et dans vingt
autres pour lesquels on ne l'a jamais remplacée; car il est
impossible d'être aussi vraie, aussi touchante : c'était
la nature dans tout son charme. Quand vous avez vu mademoiselle
Mars, ma chère amie, elle avait déjà pris l'emploi de mademoiselle
Contat, qu'elle seule pouvait faire oublier. Vous vous souvenez
bien certainement de sa jolie figure, de sa charmante taille, et
de sa voix, la voix des anges? heureusement ce visage, cette taille,
cet organe enchanteur, se conservent si parfaitement, que mademoiselle
Mars n'a point d'âge, n'en aura je crois jamais; et chaque soir
le public par ses transports lui prouve qu'il est de mon avis.
Je me rappelle avoir vu jouer deux
fois mademoiselle Arnoult au grand Opéra, dans Castor
et Pollux. J'étais peu capable alors de juger son talent
d'actrice; je me souviens cependant qu'elle me parut avoir de la
grâce et de l'expression. Quant à son talent comme cantatrice, la
musique de ce temps-là m'ennuyait si horriblement que j'écoutais
trop mal pour en pouvoir parler. Mademoiselle Arnoult n'était
point jolie; sa bouche déparait son visage, ses yeux seulement
lui donnaient une physionomie où se peignait l'esprit remarquable
qui l'a rendue célèbre. On a répété
et imprimé un nombre infini de ses bons mots, en voici un
que je ne crois pas connu, et que je trouve fort comique : elle
assistait au mariage de sa fille, avec la mère, la tante, et plusieurs
autres honnêtes femmes parentes de son gendre; pendant la cérémonie
nuptiale, mademoiselle Arnoult se retourne et leur dit : « C'est
plaisant! je suis la seule demoiselle qui se trouve ici. »
Une femme dont le talent supérieur
nous a ravis long-temps a succédé à mademoiselle Arnoult.
C'était madame Saint-Huberti, qu'il faut avoir entendue pour
savoir jusqu'où peut peut aller l'effet de la tragédie lyrique.
Madame Saint-Huberti non-seulement avait une voix superbe; mais
elle était encore grande actrice, le bonheur a voulu qu'elle
eût à chanter les opéras de Piccini, de Sacchini, de
Gluck, et cette musique si belle, si expressive, convenait parfaitement
à son talent plein d'expression, de vérité et de grandiose.
Il est impossible d'être plus touchante qu'elle ne l'était
dans les rôles d'Alceste, de Didon, etc.; toujours vraie, toujours
noble, ses accens arrachaient les larmes de toute là salle, et je
me souviens encore de certains mots, de certaines ilotes auxquelles
il était impossible de résister.
Madame Saint-Huberti n'était
point jolie, mais son visage était ravissant de physionomie
et d'expression. Le comte d'Entragues, très bel homme, et très distingué
par son esprit, en devint tellement amoureux qu'il l'épousa.
La révolution ayant éclaté, il se réfugia
à Londres avec elle. C'est là, qu'un soir, comme ils montaient ensemble
en voiture, ils furent assassinés tous les deux, sans qu'on
ait jamais pu découvrir, ni les assassins, ni les motifs
d'une pareille horreur.
Sous le rapport du chant, tout l'Opéra
se composait pour moi de madame Saint-Huberti; je ne vous dirai
donc rien de ceux qui chantaient avec elle, car je lés écoutais
à peine ; j'aimais mieux réserver une partie de mon attention
pour les ballets, où se montraient alors plusieurs talens remarquables.
Gardel et Vestris père tenaient le premier rang. Je les ai vus souvent
danser ensemble, notamment dans une chaconne de je ne sais quel
opéra de Grétry, chaconne qui je crois a fait courir
tout Paris : c'était un pas de deux dans lequel les deux
coryphés poursuivaient mademoiselle Guimard, fort petite
et fort maigre; ce qui fit dire qu'ils avaient l'air de deux grands
chiens qui se disputaient un os. Gardel m'a toujours semblé
fort inférieur à Vestris père, qui était grand, très
bel homme, et parfait dans la danse noble et grave. Je ne saurais
vous dire avec quelle grâce il ôtait et remettait son chapeau, au
salut qui précédait le menuet; aussi toutes les jeunes
femmes de la cour, avant leur présentation, prenaient-elles
quelques leçons de lui pour faire les trois révérences.
à Vestris père a succédé
Vestris fils, le danseur le plus surprenant qu'on puisse voir, tant
il avait à la fois de grâce et de légèreté. Quoique
nos danseurs actuels n'épargnent point les pirouettes, personne
bien certainement n'en fera jamais autant qu'il en a fait, puis
tout à coup, il s'élevait au ciel d'une manière si prodigieuse,
qu'on lui croyait des ailes, ce qui faisait dire au père Vestris
: « Si mon fils touche la terre, c'est par procédé
pour ses camarades. »
Mademoiselle Pélin et mademoiselle
Allard étaient deux danseuses du genre qu'on appelle grotesque
en Italie. Elles faisaient des tours de force, des pirouettes sans
fin et sans charme; mais toutes deux, bien qu'elles fussent très
grasses, étaient vraiment surprenantes par leur agilité
; mademoiselle Allard surtout. Mademoiselle Guimard avait tout un
autre genre de talent; sa danse n'était qu'une esquisse;
elle ne faisait que de petits pas, mais avec des mouvemens si gracieux,
que le public la préférait à toute autre danseuse;
elle était petite, mince, très bien faite; et quoique laide,
elle avait des traits si fins, qu'à l'âge de quarante-cinq ans elle
semblait, sur la scène, n'en avoir pas plus de quinze.
A l'instar, et même en rival heureux
du grand Opéra, j'ai vu s'élever l'Opéra Comique,
qui prenait la place de ce qu'on nommait la Comédie Italienne.
J'aurais peine à vous dire quelque chose de cette Comédie
Italienne, si je ne me rappelais que j'y suis allée voir
jouer Carlin, dont toute jeune que j'étais, le souvenir m'est
resté. Carlin jouait l'arlequin dans des pièces à canevas,
espèces de proverbes, qui nécessitent des acteurs spirituels.
Ses saillies inépuisables, le naturel et la gaîté
de son jeu, faisaient de lui un acteur tout-à-fait à part. Quoique
fort gros, il avait dans les mouvemens une lestesse surprenante;
on m'a dit qu'il étudiait ses gestes si moelleux et si gracieux,
en regardant jouer de jeunes chats, dont il est très vrai qu'il
avait la souplesse. Lui seul suffisait pour attirer le public, pour
remplir la salle et charnier les spectateurs; quand il a disparu
la Comédie Italienne a fini.
La troupe lyrique qui l'a remplacée,
possédait plus d'un talent remarquable et chantait les opéras
de Duni, de Philidor, de Grétry, etc. Un des acteurs les
plus aimés du public était Cailleau ; il a quitté
le théâtre lorsque j'étais encore fort jeune; je l'ai
pourtant vu jouer deux fois dans Annette et Lubin. Sa belle
physionomie, si gaie, si animée, et sa superbe voix, seraient
restées dans ma mémoire, lors même que je n'aurais
pas eu plus tard le plaisir de jouer la comédie avec lui
en société. Au moment de ses plus grands succès, il
lui arriva sur la scène Un léger accident du gosier, auquel
sont exposés tous les chanteurs; une huée étant
alors partie de la salle, Cailleau s'en trouva tellement offensé,
qu'il quitta le théâtre le soir même, et depuis, les plus
vives instances ne purent le faire consentir à reparaître
devant le public.
Outre son grand talent, Cailleau
avait beaucoup d'esprit; il était charmant en société
où sa gaieté si franche amenait la joie; il racontait à merveille,
et chez le comte de Vaudreuil, à Gennevilliers, il rendait les cercles
et les repas tout-à-fait amusans, tantôt par une anecdote piquante,
tantôt en nous chantant, avec sa belle voix, les romances et les
chansons qui se faisaient alors. Comme il était grand chasseur,
on le mettait de toutes les parties de chasse. Le comte de Vaudreuil,
pour lequel il avait, été si aimable, lui fit donner
par monseigneur le comte d'Artois un petit castel, nommé
le Belloi, qui se trouve au bout de la terrasse de Saint-Germain,
et qui avait un fort joli jardin.
Cailleau vivait là le plus heureux
des hommes avec sa femme et son enfant. J'ai été passer
quelques jours chez lui, et, dans son bonheur, il me rappelait exactement
ce Lubin, dont je lui avais vu si bien jouer le rôle. M. le comte
d'Artois, en lui faisant don du petit castel, l'avait nommé
capitaine des chasses de tout l'arrondissement. Il en portait l'uniforme,
et c'est; avec cet habit que je l'ai peint, tenant son fusil sur
l'épaule. Sa belle et riante physionomie m'inspirait au point
que j'ai fait ce portrait en une séance (1).
Lorsque la révolution arriva,
Cailleau fut très suspecté, comme ayant reçu des bienfaits
d'un prince. On m'a dit, mais je ne veux pas le croire, qu'il s'était
montré ingrat, et qu'il avait joué le rôle de jacobin.
Si la chose est vraie, je suis persuadée que la peur et sa
femme lui avaient tourné la tête. J'ai des raisons pour croire
que sa femme était fort révolutionnaire : en 1791,
je reçus à Rome où j'étais alors, une lettre dans laquelle
elle m'engageait à rentrer en France, me disant que nous serions
tous égaux, et qu'enfin ce serait l'age d'or. Heureusement
je ne la crus pas ; car on sait quel âge d'or a suivi ! Peu de temps
après avoir reçu cette lettre, j'appris que madame Cailleau s'était
jetée par la fenêtre de désespoir.
Laruette et sa femme sont restés
au théâtre plus tard que Cailleau (2). Tous deux étaient
excellens dans leur genre. Mais madame Laruette surtout jouait avec
un charme, une finesse, chantait avec un goût et une expression
indicible. Elle avait plus de cinquante ans qu'elle n'en paraissait
pas avoir seize, tant sa taille était jeune et ses traits
délicats. Non-seulement elle n'était pas ridicule
dans les rôles naïfs, mais elle était charmante ; et jamais
peut-être les transports et les regrets du public n'ont été
aussi loin que le jour où quittant enfin le théâtre, elle
joua pour la dernière fois dans Isabelle et Gertrude, et
dans je ne sais quel autre opéra, les deux plus jeunes rôles
du répertoire. Quoique je l'aie très peu vue jouer, je me
la rappelle parfaitement.
J'arrive enfin à celle dont j'ai
pu suivre toute la carrière dramatique, au talent le plus parfait
que l'Opéra Comique ait possédé, à madame Dugazon.
Jamais on n'a porté sur la scène autant de vérité.
Madame Dugazon avait un de ces talens de nature qui semblent ne
rien devoir à l'étude. On n'apercevait plus l'actrice; c'était
Babet, c'était la comtesse d'Albert ou Nicolette.
Noble, naïve, gracieuse, piquante, elle avait vingt physionomies,
de mème qu'elle faisait toujours entendre l'accent propre au personnage,
et son chant n'annonçait aucune autre prétention. Elle avait
même la voix assez faible, mais cette voix suffisait au rire, aux
larmes, à toutes les situations, à tous les rôles. Grétry
et Daleyrac, qui ont travaillé pour elle, en étaient
fous, et j'en étais folle.
Ce dernier mot me rappelle un rôle,
dans lequel on a toujours vainement essayé de la copier.
Jamais on n'a pu nous rendre Nina. Nina tout à la fois si décente
et si passionnée ! et si malheureuse, si touchante, que son
aspect seul faisait fondre en larmes les spectateurs. Je crois avoir
vu Nina vingt fois au moins, et chaque fois mon attendrissement
a été le même. J'étais trop enthousiaste de
madame Dugazon pour ne pas l'engager souvent à venir souper chez
moi. Nous remarquions que si elle venait de jouer Nina, elle
conservait encore les yeux un peu hagards, en un mot qu'elle restait
Nina toute la soirée. C'était bien certainement à
cette faculté de se pénétrer aussi profondément
de son rôle qu'elle devait l'étonnante perfection de son
talent.
Madame Dugazon était royaliste
de cœur et dame Elle en donna la preuve au public à une époque
fort avancée de la révolution, un soir, qu'elle jouait
la soubrette des évènemens imprévus. La reine assistait
à ce spectacle, et dans un duo que le valet commence en disant :
j'aime mon maitre tendrement, madame Dugazon, qui devait
répondre : Ah ! comme j'aime ma maîtresse, se
tourna vers la loge de Sa Majesté, la main sur son cœur,
et chanta sa réplique d'une voix émue, en s'inclinant
devant la reine. On m'a dit qu'un peu plus tard, le public, et quel
public! voulut tirer vengeance de ce noble mouvement en s'obstinant
à lui faire chanter je ne sais quelle horreur, qu'on chantait alors
tous les soirs sur la scène. Madame Dugazon ne céda point
: elle quitta le théâtre.
La longueur démesurée
de cette lettre vous prouve, chère amie, que j'ai beaucoup aimé
moi-même à jouer la comédie; car je ne vous ai point épargné
les détails. Adieu
(1) Ce portrait a été acheté à la vente de M. Lebrun par M. le comte d'Harcour. (Note de l'Auteur.)
(2) Laruette n'a quitté qu'en 1799 (Note de l'éditeur.)
Extrait du livre :
Souvenirs de Madame Louise-Elisabeth Vigée Lebrun
Edition : Librairie de H. Fournier - Paris 1835